par Samuel Furfari
Alors que s’ouvre la COP30 à Belém (Brésil) du 10 au 21 novembre 2025, avec près de 70 000 participants attendus, il devient plus que jamais indispensable d’engager une évaluation critique de l’efficacité réelle de ces conférences climatiques. Cette nouvelle édition, par sa démesure organisationnelle, incarne le fossé croissant entre le processus diplomatique et les réalités énergétiques mondiales. Le bilan de trois décennies de négociations climatiques est sans appel : en dépit de l’accumulation de déclarations solennelles et d’engagements ambitieux, les émissions mondiales de CO₂ ont augmenté de 65 % depuis le Sommet de la Terre qui a inauguré le processus de la décarbonation.
Science-climat-énergie a demandé à Samuel Furfari de présenter à nos lecteurs la thèse de son dernier ouvrage, « La vérité sur les COP. Trente ans d’illusions » (également disponible en anglais), une analyse rigoureuse et documentée des échecs successifs de ce processus, et interroge la pertinence de sa perpétuation. Cet ouvrage est dédié au Professeur Ernest Mund, qui fut un contributeur régulier sur Science, Climat, Energie (ici).
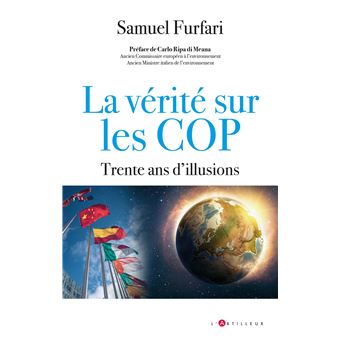
L’échec fondateur : le Protocole de Kyoto et ses illusions
COP est l’acronyme de Conference of the Parties (Conférence des États-parties), c’est-à-dire la réunion annuelle des États ayant ratifié la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Rio, 1992), afin de s’engager à réduire leurs émissions de CO₂. La première conférence s’est tenue à Berlin en 1995 sous la présidence d’Angela Merkel, alors ministre de l’Environnement dans le gouvernement d’Helmut Kohl. Dès 1994, j’ai assumé la responsabilité du dossier climatique à la Direction générale énergie de la Commission européenne, ce qui m’a permis de suivre dès avant la première COP ces conférences annuelles. Même après avoir quitté cette fonction, j’ai continué à observer ces conférences par intérêt personnel, ce qui m’a permis d’acquérir une vision approfondie du processus, même sans plus y participer directement.
Le Protocole de Kyoto (1997) devait marquer l’avènement d’une gouvernance climatique mondiale contraignante. En fixant pour les pays industrialisés un objectif de réduction de -5,2 % des émissions d’ici 2010–2012, il inaugurait l’ère des engagements chiffrés. La réalité a rapidement déçu les espoirs : l’administration Clinton-Gore des États-Unis, alors premier émetteur mondial, a refusé de ratifier le traité, pourtant négocié par elle, tandis que le Canada s’en est retiré en 2011. Plus grave encore, les mécanismes de flexibilité ont permis un transfert virtuel des émissions plutôt qu’une réduction effective. Entre 1990 et 2010, les émissions mondiales ont augmenté de 32 %, mettant en évidence l’inefficacité structurelle d’un système exemptant les pays émergents de toute contrainte.
Souligner que cet objectif devait être atteint en « 2010–2012 » ― une exigence des écologistes ― n’est pas un détail : cette échéance visait à alimenter le discours d’urgence permanente. Non seulement les objectifs n’ont pas été atteints en 2012, et a fortiori en 2010 ; mais ce procédé entretient une pression constante sur le débat public.
On notera qu’à la COP3 il n’y avait aucun chef d’état et de gouvernement, mais rien que des ministres de l’Environnement et qu’il était donc facile de se mettre d’accord sur des objectifs utopiques.
La débâcle de Copenhague : le révélateur des divisions Nord-Sud
La COP15 de Copenhague, tenue en décembre 2009, était censée marquer un tournant décisif dans la gouvernance climatique internationale en définissant un cadre successeur au Protocole de Kyoto qui avait été un échec inavoué. Cette conférence, pourtant très attendue, se solda par un échec retentissant puisqu’aucun accord juridiquement contraignant ne put être conclu. Ce sommet fit émerger au grand jour une fracture profonde et durable entre pays développés et pays en développement, notamment quant à la répartition des responsabilités climatiques.
Contrairement à Kyoto, la COP15 vit une forte présence des chefs d’État et de gouvernement, qui prirent la main dans les négociations pour éviter que des ministres « écologistes » ne conduisent leurs pays à adopter des engagements trop contraignants, jugés irréalistes compte tenu des enjeux économiques. Cependant, une fois exposées les conséquences économiques dramatiques potentielles d’une décarbonation, de nombreux États firent marche arrière. Il ne fut plus question d’objectifs contraignants ni même indicatifs au niveau global.
Les nations émergentes, en particulier la Chine et l’Inde, menèrent un refus catégorique de toute limitation significative de leur développement économique au nom de la lutte contre le changement climatique. Elles s’appuyèrent sur le principe fondamental de « responsabilités communes mais différenciées », affirmant leur droit au développement économique sans contraintes excessives, au regard des émissions historiques disproportionnées des pays industrialisés. Ces positions furent centrales dans le rejet d’un traité contraignant et connurent une forte résistance sur la scène internationale.
La conférence s’acheva dans un climat de confusion et de tensions diplomatiques, illustrant l’incapacité des instances onusiennes à concilier intérêts nationaux divergents et gestion de biens publics mondiaux.
L’échec de Copenhague a marqué un tournant majeur dans la gouvernance climatique internationale, révélant que le consensus onusien ne pouvait plus dissimuler les véritables conflits d’intérêts stratégiques entre pays développés et pays en développement. Sous la pression des activistes et des médias, les chefs d’État et de gouvernement (Barack Obama, José Manuel Barroso, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Xi Jinping,…) ont été piégés, pressés d’envisager des mesures qui auraient nui à leur économie nationale, mais ils ne cédèrent pas et préférèrent l’échec. Depuis, certains assistent brièvement à l’ouverture des COP pour « être sur la photo », puis quittent rapidement les débats afin d’éviter toute responsabilité quant à l’absence de décisions concrètes. Pris au piège une fois, ils prennent désormais soin de ne plus participer aux négociations.
Le désaccord de Paris : la consécration de l’incantatoire
Présenté en grande pompe comme un succès diplomatique historique, l’Accord de Paris de la COP21 (2015) est en réalité le triomphe de l’art français de la diplomatie. Pendant des mois, la diplomatie française a œuvré pour convaincre un maximum de pays à accepter cet accord international. On notera que ce n’est pas un protocole comme pour Kyoto, car il n’aurait pas résisté aux processus de ratifications dans nombre de pays. Rien que cette considération de droit international démontre la vacuité de ce qui est présenté comme un succès français.
Laurent Fabius, les larmes aux yeux, clamait que c’était un événement historique… mais regardons les faits, dix ans après : c’est surtout un échec monumental. Il fallait bien essayer de sauver le mandat présidentiel de François Hollande, mais manifestement, cette COP n’a pas réussi à inverser la tendance. Hollande n’a même pas eu le courage de se représenter. L’accord de Paris ne lui a servi à rien. Ni à lui ni aux autres si ce n’est de faire croire à l’UE et aux activistes qu’ils avaient inversé la marche du monde.
Dans mon livre, j’ai d’ailleurs intitulé le chapitre qui est dédié à cette COP « Le désaccord de Paris » car ilest vide de substance. Il ne contient rien d’autre que des obligations bureaucratiques, qui n’ont pour effet concret que de créer du travail administratif superflu — ce qui, ironie du sort, génère du CO₂ supplémentaire inutile. Une belle farce écologique car les consommations d’énergies fossiles mondiales n’ont cessé d’augmenter. Leur part reste écrasante, près de 87 % du mix énergétique mondial. Rien dans cet accord ne change réellement les choix énergétiques des États, les énergies fossiles étant toujours plébiscitées car sur dix ans elles représentent 77 % de la croissance de la demande, c’est-à-dire que le gouffre qu’il y a entre elles et les énergies renouvelables ne cesse de se creuser (voir l’article « Addition d’énergie, pas transition : les énergies fossiles restent le socle du progrès » du 18 juillet 2025 dans Science-climat-énergie).
Paradoxalement, l’énergie nucléaire — seule source décarbonée capable de fournir une électricité abondante et pilotable — demeurait jusqu’à la COP 28 marginalisée dans les négociations climatiques internationales. Or, le développement de technologies nucléaires avancées, y compris les petits réacteurs modulaires, représenterait une solution crédible face au double impératif du développement économique et de la réduction des émissions de CO₂ pour ceux qui y croient encore. Persister à exclure cette option du mix énergétique mondial constitue une erreur stratégique majeure, voire une faute historique.
Le tournant géopolitique : la révolte des pays en développement
Le paysage géopolitique a considérablement évolué depuis le désaccord de Paris, marquant une rupture définitive avec le paradigme de la décarbonation. L’ouverture de la « COP29 » en 2024 à Bakou par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, affirmant que « l’énergie fossile est un don de Dieu », a symbolisé ce changement de cap. Cette déclaration reflète une réalité plus profonde : les pays africains et asiatiques refusent désormais ouvertement toute limitation de leur développement au nom de la lutte contre le changement climatique. Comme le démontrent les besoins énergétiques du continent africain — où 180 millions d’habitants vivent dans des villes de plus de cinq millions d’habitants —, l’électrification ne peut absolument pas reposer sur les énergies renouvelables intermittentes. L’exigence d’une énergie abondante et bon marché devient la priorité absolue, reléguant la décarbonation au second plan.
Ce changement était déjà perceptible dès la « COP » de Glasgow, où le Néerlandais socialiste Frans Timmermans, alors premier vice-président de la Commission européenne, avait convaincu le fantasque écolo Boris Johnson ― bien que se présentant comme conservateur ― de bannir le charbon. Eh bien, ils sont tous les deux hors course à présent, et la consommation de charbon ne cesse de croître. Après Glasgow, nous avons eu droit à des COP organisées chez les pays pétroliers (Égypte et ÉAU) qui ont réorienté la conférence en faveur de la sécurité d’approvisionnement énergétique. Pire encore, à Dubaï, en marge de la COP, une conférence a eu lieu pour relancer l’« énergie nucléaire » : les activistes climatiques ont dû boire le calice jusqu’à la lie. On rappellera que le Premier ministre belge Alexandre De Croo était sur la photo, mais n’a pas pu signé l’accord sur cette relance nucléaire, car son gouvernement était sous la coupe des écolos. Après tout, à observer son parcours, on peut se demander si cet écologiste voulait vraiment être sur la photo par conviction ou par simple hypocrisie.
Observons qu’il a fallu attendre la tenue des COP dans des pays pétroliers pour que les pays en développement commencent à oser, d’abord timidement puis plus courageusement à Bakou, s’exprimer contre la décarbonation. Pendant longtemps, ils ont faire croire qu’ils s’intéressaient à la décarbonation en plaidant pour obtenir des fonds frais de la part des pays de l’OCDE. Ils étaient encouragés par les activistes climatiques qui exigeaient le « transfert de technologies », c’est-à-dire offrir des technologies, comme si la technologie n’était pas une valeur commerciale appartenant à des entreprises privées, et qu’il suffisait de la céder gratuitement aux pays moins nantis. Ce n’est que lorsqu’ils ont compris que l’argent n’affluerait pas comme ils l’espéraient et que la technologie doit s’acheter qu’ils ont osé cesser de soutenir les activistes écologistes.
Comment ne pas voir que dans tout ce processus des COP il n’y a eu que manipulations idéologiques, opportunisme politique et appât du gain ?
L’urgence du développement contre le dogme climatique
Les dernières COP ont montré que la véritable priorité des populations des pays en développement — en particulier la Chine et l’Inde — n’est pas la réduction des émissions de CO₂, mais bien l’accès effectif et rapide au développement économique et social (grâce au recours massif au charbon ― l’énergie qui produit le plus de CO₂ par unité d’énergie fournie ―, Narendra Modi est parvenu à électrifier le milliard quatre d’Indiens). Seule une électrification massive permet le décollage industriel, la création d’emplois et la diminution structurelle de la pauvreté ; c’est ce que demandent les dirigeants africains.
Dès lors, les politiques énergétiques doivent reposer sur des solutions offrant fiabilité, coût raisonnable et densité énergétique — exigences auxquelles seules les formes conventionnelles d’énergie, fossiles et nucléaire, répondent aujourd’hui à l’échelle que réclament ces pays. Promouvoir la décarbonation en privilégiant exclusivement les sources renouvelables intermittentes, c’est condamner d’avance ces nations à demeurer dans un état de sous-développement énergétique chronique. Et elles ne l’acceptent plus, c’est pourquoi les COP ne seront jamais un succès.
Cette réalité vient d’être explicitement reconnue par Bill Gates, qui affirme désormais que la décarbonation ne saurait constituer une priorité, puisqu’aucune catastrophe climatique imminente n’est pas scientifiquement constatée, comme ne cesse de la clamer de nombreux scientifiques y compris dans Science-Climat-Énergie et ceux de l’association Clintel. Cette position, longtemps défendue par de nombreux scientifiques, économistes et penseurs critiques, a été systématiquement marginalisée par une presse trop acquise aux thèses des activistes écologistes, qui leur refuse tribune et débat contradictoire.
L’éradication de la pauvreté nécessite de toute évidence une utilisation massive d’électricité, ce qui implique la construction de centaines de centrales électriques conventionnelles : charbon, gaz, hydroélectrique et nucléaire. Refuser cette réalité, c’est entretenir l’illusion au détriment du sort des populations les plus vulnérables. Les activistes ont d’ores et déjà perdu la bataille du climat ; n’en déplaise à la Commission européenne, qui s’obstine dans une politique de décarbonation économiquement suicidaire, déconnectée des enjeux réels du développement.
Observons que ce ne sont ni les déclarations de Donald Trump ni celles de Bill Gates qui ont mis fin à l’utopie des COP, mais bien les trente années d’échecs persistants que les médias et la Commission européenne ont dissimulés et continuent de dissimuler. Ils portent une lourde responsabilité.
Dans mon livre, je cite de nombreux événements illustrant le caractère erroné de ces rencontres : un ministre de l’environnement sévèrement réprimandé par son Premier ministre pour des décisions insensées ; l’organisation, à Varsovie, d’une conférence pour la promotion du charbon en pleine COP ; des changements de ministres en cours de réunions à cause de leur inefficacité ; ou encore des discussions ubuesques portant sur la taille des réfrigérateurs, lorsque lors de la COP2, l’ambassadeur des États-Unis déclara : « vous n’allez pas décider de la taille de nos réfrigérateurs ». Cette répartie fait directement écho à la célèbre phrase du scientifique de l’atmosphère Richard Lindzen : « Si vous contrôlez le carbone, vous contrôlez la vie ». Il s’agit là, selon lui, du rêve ultime de bureaucrates : prétendre contrôler la vie.
Pour une réorientation fondamentale des priorités internationales
Le constat est sans appel : le processus des COP a échoué dans son objectif fondamental de réduction des émissions mondiales. Sa perpétuation procède désormais d’une routine institutionnelle inutile. Les sommes considérables consacrées à ces conférences — chaque COP coûtant environ 100 millions d’euros — seraient infiniment mieux utilisées pour financer des projets concrets de développement énergétique dans les pays du Sud. L’urgence n’est pas dans l’organisation de nouvelles grands-messes climatiques, mais bien dans la reconnaissance du droit au développement et la fourniture des moyens énergétiques indispensables à sa réalisation.
Retour au Brésil après Rio 1992
Trente ans après la première Conférence des Parties (COP) à Berlin, le bilan est accablant : les émissions mondiales de CO₂ ont augmenté de près de 65 % depuis les engagements adoptés à Rio de Janeiro, illustrant l’échec manifeste d’un processus dirigé par des activistes et des politiques en quête de popularité qui a sacrifié l’action concrète à l’incantation stérile. À la veille de la COP30 de Belém, où quelque 70 000 participants sont attendus, tout indique qu’une nouvelle occasion sera manquée.
Le contraste est saisissant : le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva qui va ouvrir la COP30 vient à peine d’autoriser des prospections pétrolières dans la partie brésilienne de la « marge équatoriale », ce nouvel eldorado qui s’étend du Guyana, via le Suriname et la Guyane française, jusqu’au nord-est du Brésil, au large du fleuve Amazone. Ce vaste bassin, actuellement en plein développement, incarne la collision brutale entre les impératifs économiques et la rhétorique internationale sur le climat.
Si le Brésil aspire à remplir la promesse de Stefan Zweig d’« être le pays d’avenir et de nourrir le monde », il devra nécessairement compter sur une production énergétique abondante — et donc sur une exploitation accrue d’énergies fossiles. Cette orientation est en totale contradiction avec les objectifs affichés de la COP que le pays s’apprête pourtant à accueillir. Comme le montre cet ouvrage, le processus des COP donne malheureusement trop souvent lieu à une hypocrisie récurrente.
En outre, il incombe aux journalistes une lourde responsabilité : celle d’avoir failli à leur mission critique en ne dénonçant pas l’immense farce de ces conférences, contribuant ainsi à entretenir l’illusion d’une décarbonation engagée alors que les dynamiques profondes demeurent inchangées.
Il est temps de tourner la page des illusions climatiques et de reconnaître que la priorité mondiale doit être le développement économique et l’accès à l’énergie pour tous. Comme le démontre l’évolution des positions des pays émergents, l’avenir appartient non pas à la décarbonation idéologique, mais au pragmatisme énergétique qui seul peut répondre aux aspirations légitimes des populations à la prospérité, à la qualité de vie et au bien-être. Le moment est venu d’abandonner un processus onusien qui a fait la preuve de son inefficacité et de réorienter les efforts internationaux vers les véritables priorités : la lutte contre la pauvreté et le développement économique pour tous par l’accès à l’énergie abondante et bon marché.
Faut-il attendre la COP99 pour admettre l’échec ?
La vérité sur les COP. Trente ans d’illusions. L’Artilleur, 20 €
Disponible en anglais, en paperback et numérique.
Merci à l’auteur pour cette rétrospective accablante.
Pourquoi cela a-t-il duré aussi longtemps et persiste encore alors que tout converge vers une absence de rôle du CO² dans la variation du climat ou -du moins- une non-démontrabilité de ce rôle.
En 2008, juste avant Copenhague, un essai intitulé « Trading emissions » était publié. Il disait en substance que « le réchauffement du climat était un problème mondial et qu’il ne pouvait être efficacement combattu que par un gouvernement mondial. Pour financer un tel gouvernement, une taxe sur les émissions de CO² s’imposait au niveau mondial »
Devinez qui l’a écrit?
Un certain Simon Linett, accessoirement fondé de pouvoir de la banque Rothschild de la City.
« » » » »Observons que ce ne sont ni les déclarations de Donald Trump ni celles de Bill Gates qui ont mis fin à l’utopie des COP, » » » » » » »
Alors plus de COP?
Mais que va faire tout ce monde qui vivait de cela ?
Et bien s’investir dans le développement de l’énergie nucléaire 😇
Plus de COP ? Holà! Faut pas retirer le pain de la bouche de tous leurs « profiteurs » !
Or la liberté d’expression accessible via Internet, ça les dérange au plus haut point !
Ainsi peut-on lire *l’opération de musellement* déjà actée parmi Etats x ONU…
[[ At COP30, Countries Sign First-ever Declaration to Control Info on Climate…
Andrew Muller Nov. 13
Germany, France, Canada, and Belgium are among 12 nations that signed on to the “Declaration on Information Integrity on Climate Change,” documenting the so-called “threats” that free speech and the free press pose to what U.S. President Donald Trump refers to as the climate “con job.”
Signed at the United Nations’ COP30, the UN’s annual climate confab, the declaration marks the first time that “information integrity” has been on the docket for COP’s Action Agenda.
The rise of independent media, social media, and the internet has created a source of *non-establishment* news that has elevated legitimate criticism of the so-called man-made climate-change agenda.
Rather than addressing concerns about the UN’s horrible track record of climate predictions, the failure of “green” energy, and the astounding hypocrisy of climate evangelists’ jet-setting across the globe in private jets emitting mass amounts of carbon, the UN has instead turned to censorship and narrative control.
(cont’d …) :
* Defeating the “Obscurantists”
* Pushing Propaganda
* Governments Needed to Enforce ]]
By chance : Offering a Counter Narrative ? Read the full article via :
https://thenewamerican.com/world-news/un/climate-conference/at-cop30-countries-sign-first-ever-declaration-to-control-info-on-climate/
Pamphlet relatif à la COP30 et ses activistes, dénués de réalisme !
Chaque fois où il nous arrive de consulter des articles/vidéos de médias toxico-climatologiques (toutes sources confondues), avec leurs thèmes d’occurrence fréquente, poserons-nous la question des effets sociologiques pervers qu’ils créent à l’évidence ? Au choix : concussion ? et/ou corruption mentale ? Ceci se jouant entre certains « scribouilleurs idéologisés » et des « universitaires, dits à succès ».
Car les uns et les autres s’appuient là sur une science exposée au rabais !
Rien d’étonnant alors qu’en cette saison des COP (la 30e doit bien se terminer sur quelques « acquis légaux a minima », sur une nourriture toxique pour les peuples ignorants, gens dont l’esprit critique érodé est exploité par les précédents nommés.
Plus grave encore ? Quand desdits « ministres du climat » (dont un belge) jouent de mimétisme, comme les caméléons amazoniens ! Ceci s’est officiellement constaté dès que la Colombie (ce pays des cartels aux drogues dures, aux FARC, etc.) y mène une danse énergétique appuyée par 80 signataires clonés. Une gesticulation pleine de coloris… exigeant de l’ONU-GIEC et alius, l’émission d’une feuille de route « pour sortie des énergies fossiles Oil&Gas ». Forcément, ces 80-là quémandent pour la 30e fois un TROC en milliards d’euros/dollars annuels, plutôt que s’enrichir par l’or noir et grâce à de vraies industries, créatrices d’emplois pour leur propre population !
Ah, l’esclavagisme climatique…
A cet égard je n’ai pas lu qu’y souscriront le Venezuela voisin, les EAU et autres du M-O, les Algériens, le Nigeria, l’Angola, l’Egypte, la Russie, le Canada, les USA, ni UK et la Norvège, ni bien sûr les consommateurs des Balkans (a fortiori celles populations de l’Inde et de la Chine)… J’en oublie ici ?
Au « Hall of Shame » politico-scientifique, nos chères presses préfèrent vite interviewer un « Pr. Sc Po, auto-déclaré spécialiste en futurologie climatique », voire un autre « Dr en géoscience-environnement-éducation et ScPo », formes de devins qui nous profile l’Europe en 2049 (échéance fixée par le pouvoir communiste chinois pour dominer la planète à tous égards)!!! Acteurs abscons qui englobent là dedans toutes les rodomontades établies, sans preuves rigoureuses ni nuances, avec leurs quelques chiffres/graphiques concoctés dans N « modèles prévisionnels » via leurs réseaux GIEC-IPCC d’horizon 2050-2100 », c-à-d quand eux tous seront passés à trépas ? Ça fait toujours grimper leurs droits d’auteur !
S’y joignent : de nombreuses ONGs (des réseaux peuplés de lobbyists intéressés), dont l’un ou l’autre think tank para-politique « Institut du développement durable et des R.I. », celui de la circularité des idées (Icedd), ceux flanqués d’études jamais référencées avec rigueur (…). Bref un melting-pot d’influenceurs aux visées fort éloignées du terme « sans but lucratif » mais souvent idéologiques !!!
Déplorons enfin un dernier carré journalistique (nos gazettes et chaînes TV – YT) ?
Ces subtils modeleurs des esprits auditeurs (hors les nôtres) ! Leur verbiage-clé réapparaît avec la COP30 : « le dérèglement climatique » ! Soit des phénomènes littéraires afin de mieux culpabiliser l’humain. Ils agiraient – croient ces dits experts – sur la T° moyenne du globe (sic), sur la fonte des glaces arctique et celle des glaciers, sur la montée d’eaux océaniques qui infléchissent leurs lents méga-courants. Aussi avec des thèmes culpabilisants, à propos d’espèces en voie de disparition (hormis la leur), sur des forêts amazoniennes trop polluées par une déforestation agricole (celle de chez Lula). De surcroît, acteurs culpabilisants encore à l’égard de nos agriculteurs soumis aux normes hasardeuses imposées par l’UE. Enfin, ils agiraient sur la santé mentale mondiale, par l’invocation de pandémies ravageuses d’origines inconnues, etc. etc. !
Quel est le remède souverain préconisé par ces gens-là ? Ben celui d’aller pomper des ressources (en forme de textes abscons à inscrire au droit international ?), plus des ressources sonnantes financières réclamées à l’étranger ..sous « catalyseur CO2 ».. Pomper donc ces ressources chez des voisins plus rigoureux et parmi les entreprises qui créent réellement le PIB – PNB (de nos États, toujours en quête de taxes ajoutées), chiffres plus tangibles que leur facteur GINI.
QUEL BILAN pour ces initiatives floues et la nième COP terminée ce 22 nov.?
1) La rigueur scientifique y est galvaudée, au profit d’une gouvernance normative et voulue mondialisée,
2) Des vérités démocratiques qui n’y ont plus droit de Cité (nos libertés entravées, par mesures coercitives),
3) Des dettes publiques engouffrées en projets & subsides dispersés, souvent d’effets incontrôlables par la suite,
4) La climat social y reste tendu. Chez beaucoup de nos concitoyens ça détruit l’espérance d’un futur bien-être,
5) Ces motivations finissent par heurter les VRAIS chercheurs et des gens productifs, pour le meilleur profit de qui ?
Questions de fonds :
Face aux réalités des grands pays consommateurs, QUE NOUS ONT FAIT GAGNER ces « mesures » édictées par l’ONU, par le Green Deal d’une UE 27, alors que la démographie indigène occidentale est en berne (tandis qu’elle explose sans compter ailleurs pour y entretenir la pauvreté? )… ceci partout avec l’OCDE à 31 Etats dits avancés qui eux s’interrogent !!!
A chacun de méditer ces aspects et le clamer haut et fort…