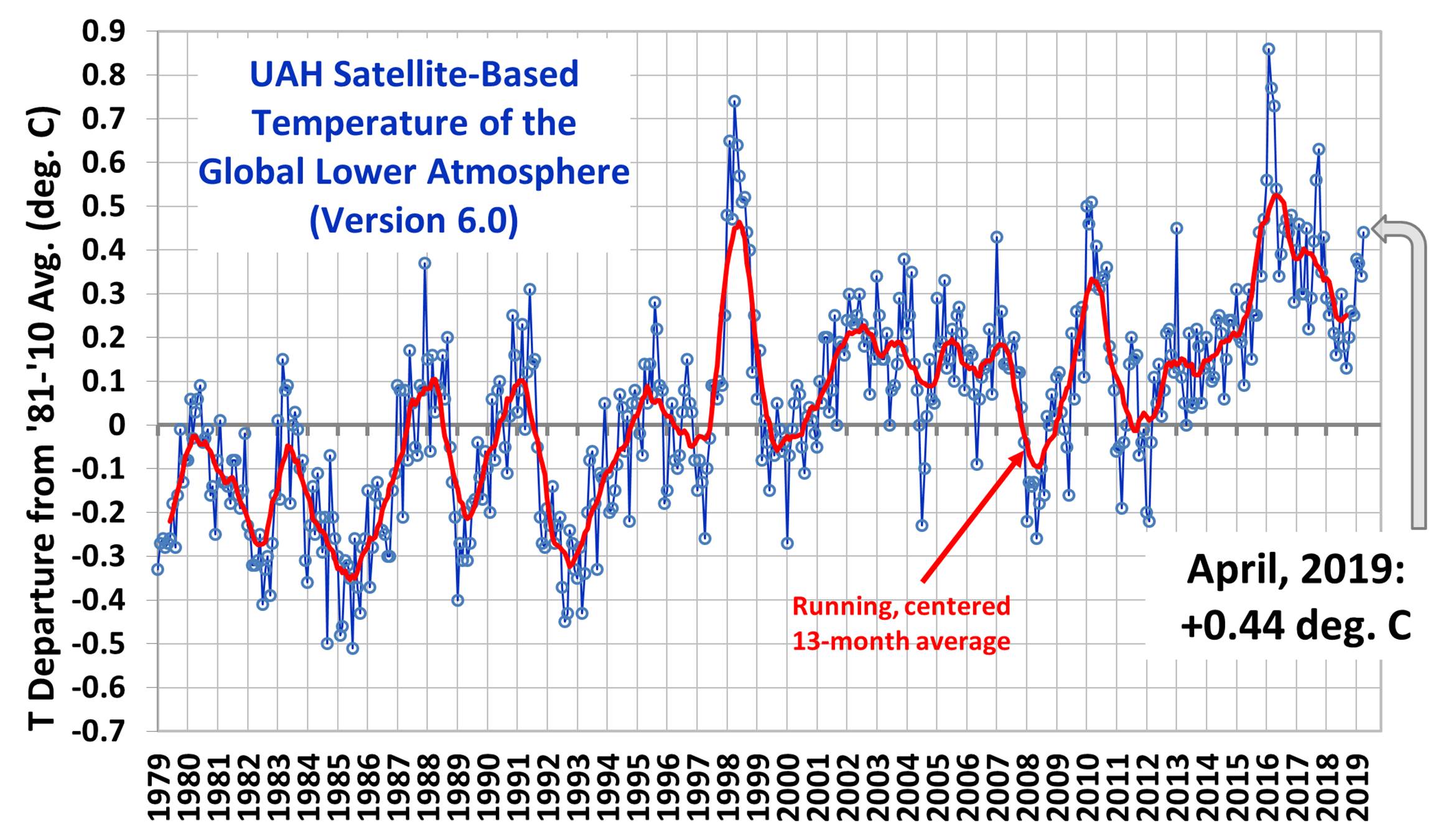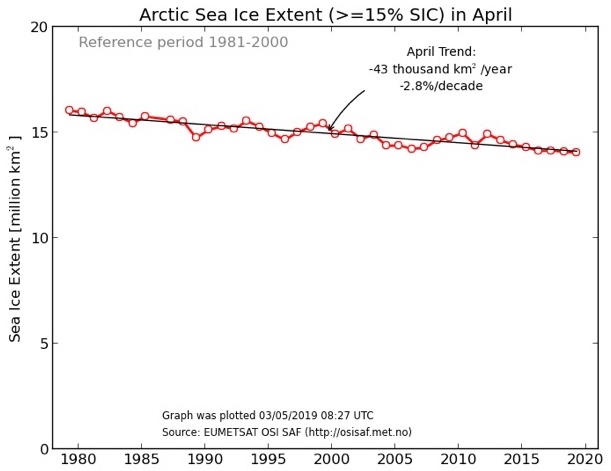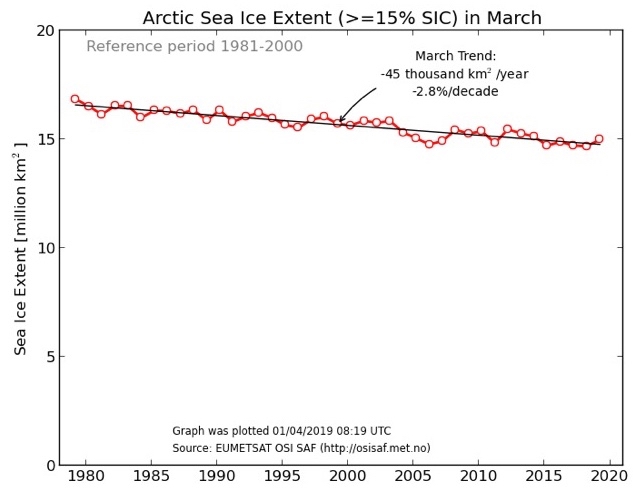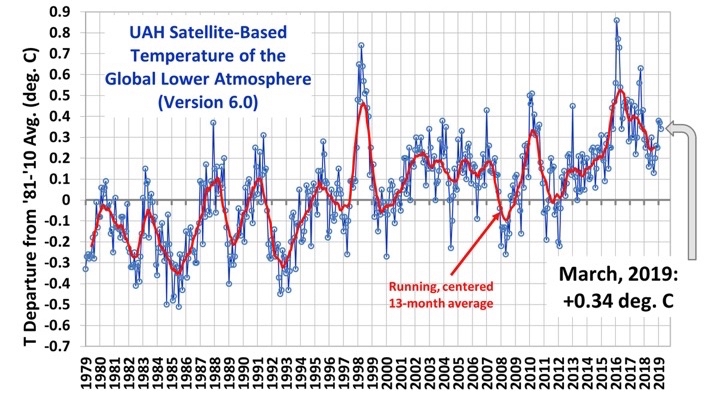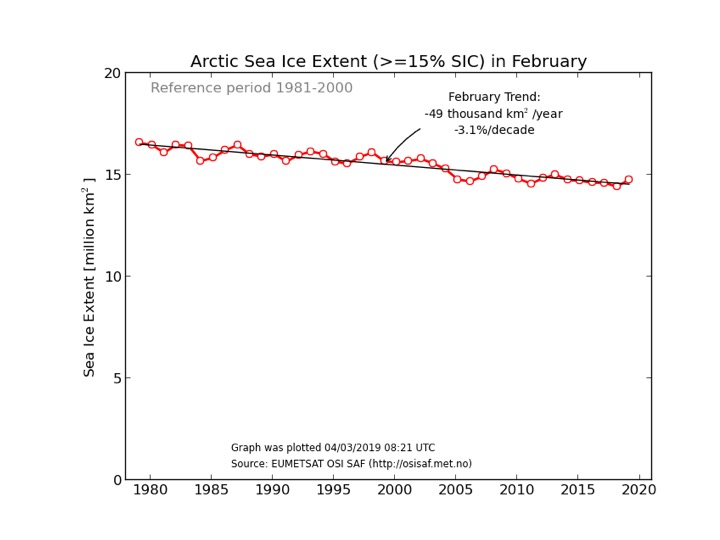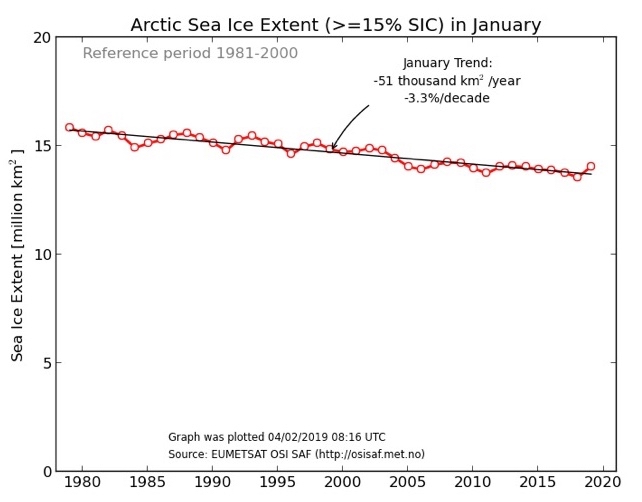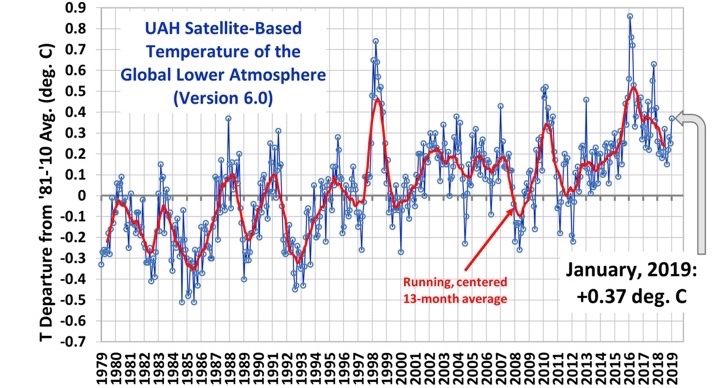par Samuel Furfari, Professeur de l’Université libre de Bruxelles.
1/ Introduction
La Commission européenne a publié dès le début de l’année 2019 son rapport sur l’évolution des prix et coûts de l’énergie en Europe. On peut y lire que l’étude de ces coûts devrait conduire à « veiller à̀ ce que les entreprises ne soient pas désavantagées ni écartées » et que « les prix de détail (réels) dans l’Union sont plus élevés qu’aux États-Unis, au Canada, en Russie, en Chine et en Turquie, mais inférieurs à̀ ceux observés au Japon et au Brésil. » Le graphique suivant (Figure 1) illustre bien le fait que les industries européennes sont pénalisées par rapport aux entreprises d’autres pays qui sont des concurrents directs sur les marchés internationaux, y compris pour nos importations. Le rapport ajoute pudiquement, sans y insister que « l’évolution des prix de l’électricité est dominée par les taxes et prélèvements ».
Continuer la lecture de L’aluminium, symbole du désarroi climatique ? Pas pour tous….