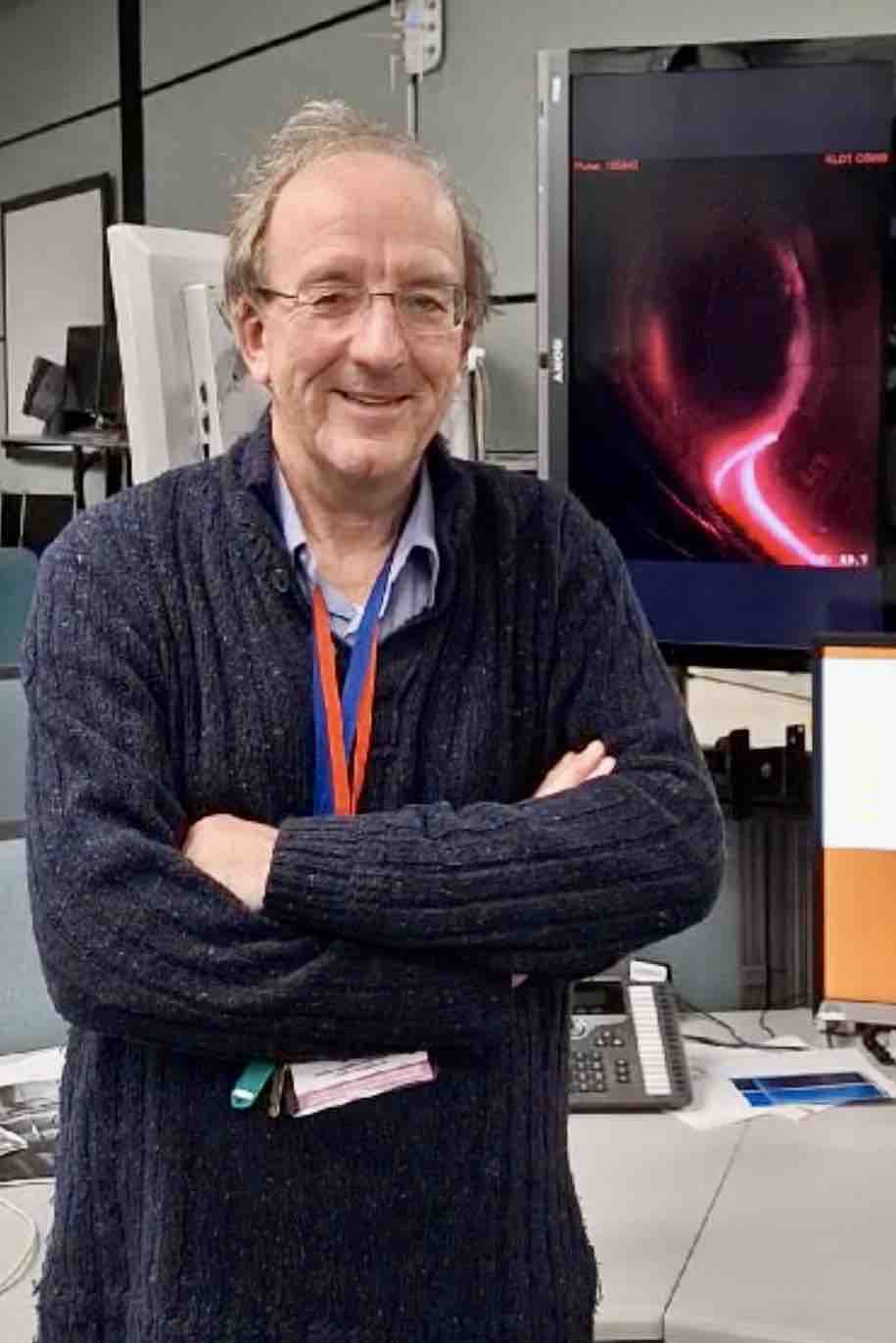par Jean-Pierre Schaeken Willemaers, publié le 14/05/2025 dans Energie
Les batteries sont omniprésentes dans notre vie quotidienne : dans les appareils électriques d’usage quotidien, dans le transport de manière générale, les voitures, qu’elles soient thermiques ou électriques, les camions, les trains, etc. Le choix des matériaux des composants des batteries est fondamental pour assurer des prix acceptables et les performances requises.
La pertinence de ce choix est analysée ici puisque, dans le cadre de la transition énergétique, les batteries sont devenues un des outils principaux de l’électrification accélérée du système économique européen ainsi que du stockage de l’énergie nécessaire à la compensation de l’intermittence des productions électriques éoliennes et photovoltaïques.
Les composants précités sont les électrodes et l’électrolyte. Une batterie est en effet composée de plusieurs cellules connectées les unes aux autres, chacune d’entre elles étant constituée de quatre éléments: une électrode positive, une électrode négative, un électrolyte et un séparateur entre les deux électrodes qui ne permet le passage que des ions. Les électrodes sont raccordées à un circuit électrique extérieur via un collecteur de courant (une plaque conductrice).